Kashink, street artist française incontournable, porte sur son visage une fine moustache dessinée à l’eyeliner depuis 2013. Ce geste traduit de sa part une certaine idée de la performance au quotidien, au-delà de son domaine de prédilection l’art urbain, qui interroge le genre, la féminité, les codes de la beauté, la norme. « On n’attend pas d’une femme qu’elle ait une moustache » confiait-elle dans un entretien à la presse il y a quelques années. Cet élément indissociable du personnage public mais également de la personne privée est devenu un symbole. Pour « jouer avec la représentation féminine », Kashink incarne elle-même le propos de son oeuvre. Le parallèle avec le street art frondeur par nature et qui tend à brouiller les pistes se fait naturellement. Le style flamboyant empreint d’humour caractéristique de la graffeuse à la forte personnalité confère à ses interventions une étrangeté volontiers ludique. Kashink affiche des affinités esthétiques avec le Pop art mâtinées d’influences punk et rock. Elle s’inspire des cultures populaires du monde, empruntant des motifs aux traditionnels alibrejes mexicains, à la cosmogonie hindoue, à l’art naïf haïtien. Colorées très graphiques, ces illustrations narratives projetées au cœur même de la ville illustrent son engagement personnel. Elle se définit comme une activiste, féministe dans l’âme. « Ça m’est venue comme une évidence que faire du street-art permettait de partager des idées… Le street art, ce n’est pas juste joli. C’est important qu’il y ait un message. Etre artiste c’est aussi avoir une pensée, une réflexion sur le monde qui t’entoure. » Son oeuvre rend hommage à l’altérité. « Le but de ma démarche qu'elle soit artistique ou personnelle, c'est de célébrer la diversité de l'humanité ».
Née en 1981 à Alès, en Occitanie, Maeva future Kashink, nom d'artiste inspiré par les onomatopées des comics - Bang ! Vlop ! Shebam ! Zip ! - emménage dans le XXème arrondissement de Paris à l’âge de 17 ans. Après le bac, elle tente sans succès les concours d’entrée d’écoles d’art. Elle envisage un temps de devenir tatoueuse. Vocation artistique contrariée, elle poursuit des études universitaires classiques de communication puis travaille durant quatre dans les ressources humaines. Elle accompagne alors des reconversions professionnelles. Mais ce travail de bureau la laisse très insatisfaite.
Toujours attirée par l’expression artistique, Kashink ne cesséede dessiner durant toutes ces années. Au début des années 2000, séduite par le milieu du street art, elle créée des stickers qu’elle colle à travers la ville. Elle s’essaie à la pratique de l’aérosol tout en éprouvant des réticences vis à vis de cette technique. Dans le même temps, elle suit une formation pour adulte de peintre en décor à la suite de laquelle elle intervient dans des théâtres, des cinémas, des hôtels.
En 2006, poussée par des amis qui verraient bien ses dessins projetés sur les murs de la ville, Kashink décide de se colleter à nouveau à la bombe. En apprivoisant l’outil, elle y prend goût et progresse rapidement. A l’époque, les femmes street artists ne s’expriment que selon deux modes très distincts, le style girly et la pratique purement vandale. Kashink cherche sa propre voie et choisit de casser les codes pour investir la rue. Elle réalise ses premiers murs avec des portraits sur une friche dans le Sud de la France, dans un collège en travaux dont les salles de classes vides sont sur le point d’être rasées. A ces débuts, elle intervient dans son quartier de prédilection, à Saint-Blaise dans le XXème arrondissement de Paris. Elle collabore avec Seize, REKM, Seth. Dans le graffiti, Kashink trouve une forme de liberté et de transgression inédite.
La pratique sous-tend de se réapproprier l’espace urbain, de requalifier drastiquement la géographie sensible de la ville. « Le street art n’est pas de la décoration urbaine. Si tu travailles dehors, tu as un potentiel de partage et il faut lui donner un sens activiste. Lorsque je pars à la fin de mon travail, les gens du quartier continuent de vivre avec la peinture. Il est donc primordial de donner du sens à mon travail. Cela relève d’une démarche artistique complète. » affirme l'artiste.
L’art de la rue, de la création in sitù, est aussi celui du déplacement du corps dans l’espace, expérience physique ardue, transport du matériel, prise de risque et rush d’adrénaline de l’illégalité. Inspirée par le mur, le moment, l’oeuvre s’inscrit dans une poésie de l’éphémère, la fugacité d’un art non-pérenne. Kashink travaille en improvisation, à main levée dans croquis préalable. Elle a fait de l’absence de formation classique une force. Libération du trait de la ligne de la forme. Si peindre dans la rue, acte artistique particulier, demeure son principal substrat, elle explore volontiers les différentes techniques qui s’offrent à elle, peinture, photographie, céramique, vidéo.
Elle revendique une filiation avec les plasticiens britanniques Gilbert & George, l’influence de Fernando Botero, Francis Picabia, Frida Kahlo ou encore des photographes Pierre et Gilles. Dans ses origines slaves et hispaniques, Kashink puise des hybridations incongrues et puissantes. L’iconographie traditionnelle du culte orthodoxe dans la tradition duquel elle a été élevée est une source généreuse d’inspiration, les grands aplats de couleurs des icônes, l’impact visuel de l’épure naïve, les poses particulières des personnages.
Kashink imagine des visages aux yeux multiples, des portraits à la frontière des genres. Cultures populaires et artisanats du monde lui ouvrent les mondes de bestiaires fantastiques, de créatures mythologiques. Elle emprunte et mêle en un grand foisonnement de couleurs et de signes, les alebrijes mexicains, sculptures d’art folklorique issus des célébrations de la fête d’El Dia de los Muertos, la cosmogonie hindouiste, l’art naïf haïtien, la sculpture traditionnelle africaine, les masques du théâtre asiatique. « L’idée c’est d’utiliser des symboles qui sont faciles à comprendre et qui sont presque naïfs parfois et de les présenter d’une manière à illustrer des propos sérieux parce que la vanité fait appel à la finitude, à la fin de la vie, au côté éphémère. »
En inscrivant sa recherche plastique dans la rue, le street artist intervient directement au cœur du quotidien des riverains. Pour Kashink, il est question de s’inspirer de ces lieux de vie pour intervenir en prise directe avec le réel des riverains. L’oeuvre finale, projetée sans filtre, hors du champ classique de représentation des productions artistiques que sont galeries et musées, aura un impact avec la réalité des gens. « J’adore le contact de la rue, j’en ai besoin. Voir les gens circuler, avoir un environnement mouvant, échanger avec eux, m’est essentiel.» Kashink accompagne chacune de ses créations de petits textes inspirés par la musique, les chansons qu’elle aime. Parfois, elle invente quelques mots en fonction du contexte, de l’histoire du lieu, si possible dans les idiomes locaux ou bien en anglais, langue universelle, pour les sites les plus touristiques.
Le travail de Kashink est le vecteur d’un engagement personnel très fort. En 2012, à la suite des interventions homophobes de la Manif pour tous, en réaction, elle descend dans la rue pour militer en faveur du mariage pour tous par le biais d’un projet intitulé « 50 cakes of gay ». Reconnaissance des droits des homosexuels, égalité hommes / femmes, célébration de l’altérité, protection de l’enfance, Kashink porte en couleurs ses convictions sur les murs des plus grandes villes du monde. Elle collabore bénévolement avec des associations telles que La Voix de l’Enfant, Emmaüs, Act up tandis que sa participation aux grandes foires d’art contemporain comme Art Basel Miami lui assure une renommée grandissante et lui assure des partenariats avec des marques telles que Converse ou Kronenbourg. Invitée à Berlin, Vienne, Londres, New York, Detroit, Chicago, San Diego, Kashink n’en oublie pas Paris, son point d’ancrage et participe aux Festiwall 2018 et 2019. Elle poursuit sa démarche d’art de rue en intervenant sur des rideaux de fer ou des portes de magasins fermés depuis longtemps, offrant à ses voisins du XXème arrondissement des échappées hautes en couleurs.
Caroline Hauer, journaliste depuis le début des années 2000, a vécu à Londres, Berlin et Rome. De retour à Paris, son port d’attache, sa ville de prédilection, elle crée en 2011 un site culturel, prémices d’une nouvelle expérience en ligne. Cette première aventure s'achève en 2015. Elle fonde en 2016 le magazine Paris la douce, webzine dédié à la culture. Directrice de la publication, rédactrice en chef et ponctuellement photographe de la revue, elle signe des articles au sujet de l’art, du patrimoine, de la littérature, du théâtre, de la gastronomie.
Sites référents























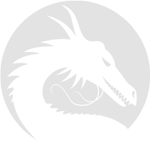










Enregistrer un commentaire