Dacruz, street artist attitré du quartier de l’Ourcq, a su affirmer son identité graphique par la multiplication des motifs instantanément reconnaissables. Masques stylisés, animaux fétiches animent des compositions colorées à l’esthétique métissée, synthèse d’éléments empruntés aux cultures traditionnelles d’Amérique du Sud, d’Afrique et Océanie. Graffeur, plasticien et acteur social, Dacruz revendique l’empreinte des influences multiples héritées de son quartier d’origine. Porté par une pensée militante, une volonté de dialogue et de partage, l’artiste ne cesse d’initier de nouveaux projets qui animent ce coin du XIXème arrondissement, créent du lien entre les générations, entre les communautés. Par le biais de son association Cultures pas Sages fondée en 2013, il organise notamment le festival Ourcq Living Colors. Cet évènement rassemble chaque année dans un cadre légal, des dizaines de street artists du monde entier. Les fresques réalisées au cœur de la ville au plus près du quotidien des riverains incarnent une philosophie de vie dans une joyeuse célébration du multiculturalisme.
Dacruz vit son art comme un engagement esthétique et politique. Ses interventions résonnent puissamment avec les problématiques économiques, politiques et sociétales actuelles. A travers ses œuvres, il interroge la mondialisation, défend la cause environnementale. Très impliqué auprès de la jeunesse, il a développé des programmes artistiques avec les enfants du quartier de l’Ourcq. Le contact avec les habitants participe pleinement de la création plastique. Le plaisir du partage est essentiel. Aujourd’hui, la gentrification progresse. Les friches, l’ancienne usine, les vestiges industriels, font l’objet de grands projets immobiliers menés par d’habiles promoteurs. Les classes populaires de l’ancien quartier ouvrier sont repoussées à la périphérie de la ville.
Dacruz a grandi au 16 rue de l’Ourcq où ses parents d’origine portugaise sont gardiens. Il a vécu la métamorphose tout d’abord architecturale puis sociale du XIXème arrondissement. Adolescent, le jeune artiste baigne dans une culture hip hop, reflet de la richesse d’un territoire où se mêlent et se croisent les formes d’expression artistique comme la musique, la danse, le graffiti. Art du prélèvement, le street art s’approprier les formes pré-existantes et célèbre le multiculturalisme.
A la fin des années 1980, l’adolescent y trouve un moyen d’expérimentation. Les murs de la ville deviennent son terrain de jeu. Il réalise ses premiers tags au marqueur Cité de l’Ourcq. Débuts vandales, sans autorisation, Dacruz, qui ne signe pas encore de son nom, est séduit par l’aspect illégal, la prise de risque, l’idée de braver les interdits. Autodidacte, sa technique évolue vite. « La rue, c’est l’école en accélérée. Une expérimentation continuelle, un apprentissage mutuel. » se souvient-il. Il fourbit ses armes autour de l’ancienne usine CPCU. Très investi dans le sport, le jeune homme y trouve un autre moyen de canaliser sa fougue, sa colère. Il ne reviendra à ses premières amours et au graffiti qu’au milieu des années 1990.
A partir de 1995, dans le quartier de l’Ourcq le déplacement des populations se fait plus prégnant. Les nombreux locaux industriels qui au fil du temps et de la désindustrialisation ont été désaffectés lui donne une apparence d’abandon culturel, humain, social. Il s’agit d’une phase mais les chantiers déshumanisent ces lieux en voie de transformation. Pour Dacruz qui peint sur les façades des immeubles murés, les parois des ilots voués à la démolition, les murs autour de l’usine du chauffage parisien, les contreforts du chemin de fer de la rue de l’Ourcq, les interventions des street artists réenchantent la ville. Les fresques se réapproprient la géographie sensible de l’espace urbain et deviennent des repères esthétiques. Le canal de l’Ourcq proche du terrain vague de La Chapelle, haut lieu du street art européen, véritable laboratoire, attire de plus en plus de graffeurs. En intervenant, Dacruz choisit d’inclure les habitants dans le processus de redéfinition esthétique de la ville. Il noue des liens forts avec les différentes communautés. Les œuvres permettent de redonner du sens à l’espace urbain, de l’habiter et le faire vivre en initiant des échanges privilégiés autour de ces fresques.
Mais pour le jeune artiste, le chemin vers la reconnaissance est long. Il enchaîne les petits boulots, vivant pour son art. « Ca devient ton oxygène, le truc qui te permet de supporter les tafs merdiques. Avant que je puisse m’avouer que c’était ma vie, et que ça devienne mon boulot, ça a pris des années. Mais ça faisait partie du chemin, ça m’a permis d’expérimenter différentes facettes de la société » confie-t-il. L’un de ces jobs alimentaires au Grand Palais sera révélateur.
Explorant différentes techniques et supports, Dacruz expérimente pour trouver un style. Du marqueur, il est naturellement passé à la bombe aérosol mais également à l’acrylique au pinceau. La création d’une iconographie personnelle est le fruit d’un processus de maturation. Kandinsky lui donne le goût de la couleur. Il est fasciné par les cultures traditionnelles sud-américaines et avoue volontiers en souriant qu’enfant il était passionné par le dessin-animé « Les Mystérieuses Cités d’or ». Pour se documenter, avant la généralisation d’internet, il fréquente assidument les musées, les bibliothèques, compulse de nombreux livres.
Lors de son premier voyage au Pérou en 2001, Dacruz a une révélation. A Nazca, il est invité à produire une fresque avec les outils locaux. Armé de trois aérosols pour peindre les voitures, il réalise un masque inspiré par ceux de la Côte d’Ivoire qu’il dote néanmoins d’un grand nez. Les Péruviens font tout de suite le parallèle avec les masques traditionnels locaux. Le motif universel du masque, indissociable des imaginaires collectifs du monde entier et porteur d’un message humaniste devient alors sa marque de fabrique. Au cours de ses nombreux voyages, en Amérique du Sud, en particulier le Brésil, à travers l’Afrique, le Moyen-Orient, Dacruz puise dans la multiplicité des représentations humaines, physique, mystique, de ce symbole mythologique. Ses totems colorés à la géométrie futuristes embrassent les traditions populaires dans un syncrétisme qui mêlent cultures ancestrales et modernité radicale, les arts premiers et l’art contemporain. Les grands aplats de couleurs délimités par d’épais traits noirs jouent des lignes simplifiées des primitifs et d’une palette chromatique vibrante.
Les voyages sont la clé d’une remise en question de l’ethnocentrisme. « La rue, par essence, est connectée à toutes les rues du monde. Graffer c’est l’idée de propager, étendre son terrain de jeux. Tu deviens ambassadeur de cette culture. Il y a des réactions communes. » affirme l’artiste. Dacruz développe une pratique artistique très personnelle. L’interaction avec les gens venus d’autres horizons, leur environnement, l’architecture ouvre l’esprit et enrichit l’expression sensible. C’est en voyageant que l’artiste prend conscience de la richesse de son quartier natal. « Initialement je suis allé à l’école de cette république, dans ces quartiers on était 15 à 20 nationalités différentes. Même si ce n’était pas facile tous les jours, parce que vivre avec la planète comme voisin de palier ce n’est pas évident, mais c’est une sacrée richesse. J’ai pris conscience de ce voyage immobile quand j’ai commencé à voyager physiquement, quand j’étais à l’étranger, sur différents continents, où finalement je retrouvais la problématique de ce qui se passait dans cette France et dans ces quartiers. Finalement c’était un petit peu le côté atomique de la mondialisation à l’échelle d’un village. »
Le travail in sitù du street artist acquiert au gré des transformations du quartier où il est projeté une dimension urbanistique. Le passage à l’atelier, à la toile, nécessite de se réinventer sous une autre forme. Laboratoire nouveau, ces compositions déclinent un univers et le complètent. Si les ventes de tableaux et les collaborations avec des marques prestigieuses lui permettent désormais de vivre de son art, Dacruz a su préserver son authenticité. Représenté par de grandes galeries après avoir essuyé de nombreux refus, sa présence dans les musées et la reconnaissance du monde l’art contemporain ne lui ont pas ôté le l’envie d’intervenir dans la rue, musée à ciel ouvert, et d’y poursuivre une oeuvre. En 2010, il est invité par la bibliothèque du Centre Pompidou à réaliser une fresque.
En hommage aux belles rencontres et aux voyages formateurs, Dacruz créé des festivals de street art dans le monde entier comme en 2012 à Dakar. Il lance des passerelles et décloisonne les pratiques. Le street art qui documente l’évolution urbaine va à la rencontre d’un public qui traditionnellement ne fréquente pas les galeries ou les musées. Les interventions créent du lien social par la dynamique joyeuse d’une pratique profondément ancrée dans le tissu urbain. Dans le quartier de l’Ourcq, la poésie du street art est profondément enracinée dans le cœur des riverains. Dacruz se fait le passeur de préoccupations écologiques, environnementales. Ses fresques nous parlent de l’inquiétude face au changement climatique, les répercussions sur les populations, la destruction des habitats naturels.
Festival Ourcq Living Colors
Caroline Hauer, journaliste depuis le début des années 2000, a vécu à Londres, Berlin et Rome. De retour à Paris, son port d’attache, sa ville de prédilection, elle crée en 2011 un site culturel, prémices d’une nouvelle expérience en ligne. Cette première aventure s'achève en 2015. Elle fonde en 2016 le magazine Paris la douce, webzine dédié à la culture. Directrice de la publication, rédactrice en chef et ponctuellement photographe de la revue, elle signe des articles au sujet de l’art, du patrimoine, de la littérature, du théâtre, de la gastronomie.
Sites référents





























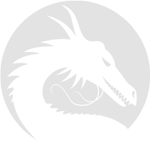










Enregistrer un commentaire